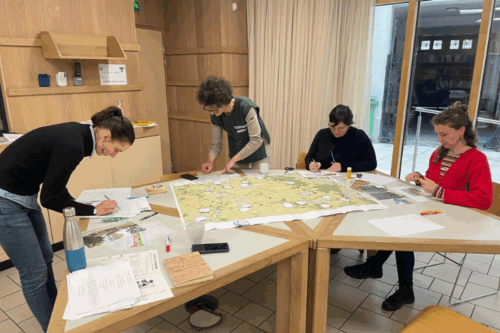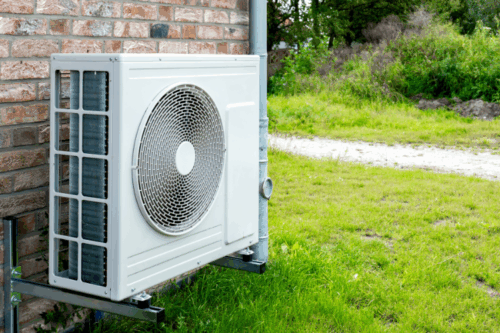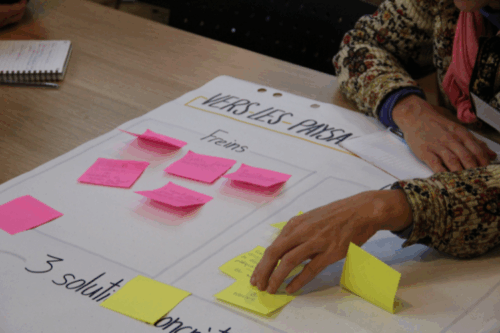Énergies renouvelables : une compétitivité largement démontrée
Depuis 2016, l’ADEME publie tous les deux ans, une étude sur les coûts de production des énergies renouvelables et de récupération. La quatrième édition de cette étude suit ces coûts sur la période 2012-2022. Pour les énergies renouvelables électriques le constat est sans appel : elles sont non seulement de plus en plus compétitives mais aussi les plus résilientes face aux crises. Le regard croisé de Nicolas Peraudeau, économiste à la direction bioéconomie et énergies renouvelables de l’ADEME, qui a piloté cette étude et de Marc Jedliczka, co-président du réseau Cler.
Quels sont les principaux enseignements de cette étude sur les énergies renouvelables ?
Nicolas Peraudeau : L’étude montre une baisse importante des coûts des énergies renouvelables électriques ces 10 dernières années, de l’ordre de -50% pour le photovoltaïque et de -40% pour l’éolien. Si on s’attache plus particulièrement à la période 2021-2022 marquée par de fortes turbulences économiques et géopolitiques, les énergies renouvelables ressortent grandies. Non seulement, elles représentent une solution compétitive par rapport aux énergies fossiles, mais elles offrent aussi des gages de stabilité dans un contexte perturbé. Enfin il est important de noter que face à ces évolutions rapides, les dispositifs de soutien aux énergies renouvelables restent utiles en permettant de réduire le risque perçu par les investisseurs tout en limitant les coûts pour l’Etat.
Marc Jeliczka : Ces résultats confirment que les filières ont su tirer le meilleur parti des aides au fonctionnement que représentent les tarifs d’achat en baissant leurs coûts de production. C’est la démonstration qu’il existe des instruments de politique publique qui fonctionnent bien. Aujourd’hui les énergies renouvelables photovoltaïques et éoliennes sont non seulement les moins chères mais elles génèrent de la valeur localement, en termes d’emploi comme de ressources. L’étude de l’ADEME évalue, en 2022, à 59€ HT le MWh éolien terrestre, et entre 70€ HT et 91€ HT le MWh photovoltaïque selon les types d’installations, sol ou toiture et leur localisation. Un chiffre que l’étude compare aux 172€/MWh de coût de production des centrales à cycle combiné gaz (CCGT). Il convient d’y ajouter que le coût de l’électricité renouvelable ne cesse de diminuer au point d’être devenu compétitif pour les nouveaux moyens de production avec celui de l’ensemble des filières conventionnelles partout dans le monde, y compris en France, et ceci en deux décennies à peine, grâce notamment aux tarifs d’achat garantis.
Comment ces enseignements peuvent-ils éclairer les décideurs politiques ?
NP : La compétitivité des énergies renouvelables électriques apporte aux ménages une électricité à moindre coût. Le développement de ces énergies garantit une plus grande souveraineté énergétique mais aussi le développement de projets de territoires qui embarquent les citoyens dans la transition énergétique. Il est donc important de conserver des dispositifs de soutien aux énergies renouvelables, et de maintenir un fort niveau d’ambition. Entre 2023 et 2024, 5 GW d’énergie photovoltaïque ont été installés en France, ce qui correspond au rythme visé pour atteindre les objectifs de la PPE. Pour l’éolien, avec 1,2 GW installés sur la même période, il faudrait accélérer le pas. C’est d’autant plus pertinent que notre étude montre bien que c’est la filière qui revient la moins chère pour le contribuable.
MJ : Il est essentiel qu’une part significative, voire majoritaire, de la valeur créée par les ressources locales que sont le solaire et l’éolien reste dans les territoires notamment ruraux, au bénéfice des collectivités locales et des habitants. À cet égard, il faut veiller à ce que les différents dispositifs de soutien (tarifs d’achat garantis, appels d’offres, complément de rémunération…) restent accessibles à ces acteurs qui n’ont pas pour métier la production d’électricité et ne favorisent pas outre mesure les grands énergéticiens « hors-sol ».
Découvrez l’étude