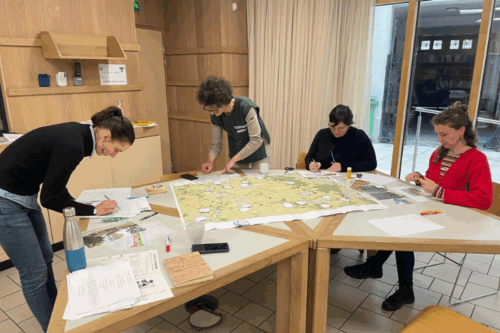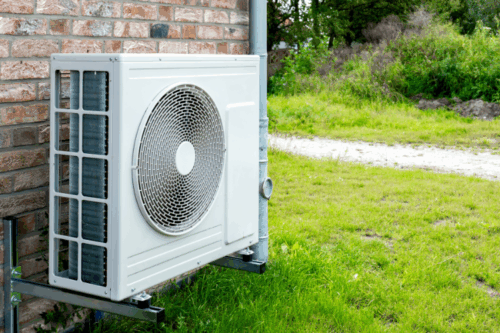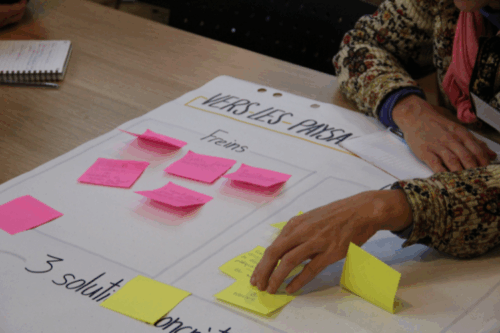Quelle intégration des énergies renouvelables en site classé patrimoine mondial ?
Alors que les projets d’énergie éolienne et solaire se développent, leur impact sur les sites classés au patrimoine mondial augmente. Comment trouver un équilibre entre la réalisation des objectifs climatiques et le respect des obligations en matière de conservation du patrimoine ? Décryptage avec Bertrand Folléa, paysagiste et directeur de la chaire paysage et énergie à l’école nationale supérieure du paysage de Versailles.
Dans son Guide sur les projets d’énergie éolienne et solaire dans un contexte de patrimoine mondial, l’Unesco relève « la nécessité de remplacer les sources d’énergie non-renouvelables par des sources d’énergie renouvelables à l’échelle mondiale » avant de préciser les conditions du développement d’installations solaires et éoliennes dans les sites inscrits sur sa liste.
Vézelay, une étude de référence pour les paysages protégés
L’organisation internationale a publié, en 2021, une étude sur le patrimoine mondial et la planification de l’énergie éolienne dans laquelle elle identifie les bonnes pratiques à travers des études de cas dans 4 pays européens. Pour la France, c’est le site de la Basilique et de la colline de Vézelay qui fait figure d’exemple, avec l’étude sur son aire d’influence paysagère réalisée par la DREAL en 2017 pour déterminer si de futurs projets éoliens pourraient porter atteinte à la Valeur Universelle Exceptionnelle (VUE) du site. « La V.U.E. désigne les critères qui justifient l’inscription d’un site sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Ces critères déterminent les choix de gestion. La question qui se pose, pour quelque projet d’aménagement que ce soit, c’est de savoir s’il va dans le sens de l’amélioration de la valeur ou de la dévalorisation » explique Bertrand Folléa, paysagiste et directeur de la chaire paysage et énergie à l’école nationale supérieure du paysage de Versailles.
L’État, représenté par le préfet, les directions régionales en charge de l’environnement et de la culture (DREAL et DRAC), la DDT, l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine (UDAP) et les collectivités travaillent ensemble pour déterminer les conditions d’inscription des énergies renouvelables dans les sites Unesco précise l’expert. Ainsi, pour Vézelay et sa colline, le travail a essentiellement consisté à examiner les zones d’implantation où l’impact visuel est le plus réduit, que ce soit depuis le site ou en regardant vers lui. Ce travail a permis de définir un zonage « de nature à assurer une protection adaptée du Bien mondial Unesco, tout en permettant l’accueil de certains projets de parc éoliens, y compris parfois avec une co-visibilité possible » conclut l’étude.
Des sites remarquables aux entrées de ville
Pour Bertrand Folléa, il faut aller plus loin : « il n’y a pas de raison de cacher les installations d’énergies renouvelables comme une maladie honteuse. Y compris dans des sites où la protection est encore plus forte que sur ceux de l’UNESCO : sites classés, monuments historiques, Grands sites de France… Il faut assumer ces aménagements avec une approche systémique. Le paysage est multi-relationnel, outre ses caractéristiques physiques, il possède aussi des dimensions sociales, économiques, culturelles, affectives… on n’a pas la même perception d’un parc éolien quand on en est copropriétaire ».
Pour lui, « la transition énergétique est une opportunité de repenser nos paysages. Il ne faut pas se demander comment mettre des énergies renouvelables dans le paysage, mais comment mettre les énergies renouvelable au service du paysage ». Il cite en exemple les éoliennes installées en bordure du canal du Rhône à Fos-sur-mer : « alignées sur la ligne d’eau, faisant le lien entre l’industrie et la nature ». L’inscription des énergies renouvelables dans le milieu de vie et la concertation autour de leur implantation font partie des bonnes pratiques identifiés dans le guide du réseau Cler « Accorder énergies renouvelables et patrimoine culturel ».
Ce qui vaut pour les sites remarquables vaut pour les paysages du quotidien : « Les énergies fossiles ont beaucoup fragilisé les paysages, engendrant leur banalisation, avec une consommation foncière et une artificialisation des sols qui entrainent de nombreux dégâts. Les paysages de l’après-pétrole seront des paysages plus désirables », poursuit-il, souhaitant par exemple que l’obligation d’implanter des ombrières photovoltaïques dans les parkings aboutisse à une requalification paysagère globale de ces espaces.